
Considérant la période de janvier à février et hormis Sotouboua qui a enregistré un excédent, l’année 2023 est déficitaire par rapport à la normale 1991-2020 au Togo en termes de cumul national moyen

Considérant la période de janvier à février et hormis Sotouboua qui a enregistré un excédent, l’année 2023 est déficitaire par rapport à la normale 1991-2020 au Togo en termes de cumul national moyen
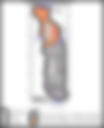
Au cours de la période de mars, avril et mai, il est prévu dans les régions Maritimes, Plateaux et Centrale, des précipitations normales qui évolueront vers une situation excédentaire. Par contre, dans la Kara et dans les Savanes, il est attendu une pluviométrie déficitaire à tendance normale.
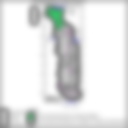
Parlant des mois d’avril, mai et juin, tout le pays connaitra une situation normale à tendance excédentaire à l’exception des Savanes où les précipitations excédentaires à normales sont prévues.






1) Face au risque de sècheresse
Les situations des cumuls pluviométriques globalement moyens, des dates de début de saison moyennes à tardives, des dates de fin de saison précoces à moyennes laissent planer des risques de déficits hydriques dans la zone bimodale (régions Maritime et Plateaux). Ces situations de sècheresse pourraient entraver la croissance des plantes et favoriser le développement d’insectes ravageurs des cultures.
Face à cette situation, il est recommandé de Face à cette situation, il est recommandé de :
2) Face au risque d’inondation
En dépit du caractère globalement moyen des cumuls pluviométriques attendus dans les parties sud Togo, il n’est pas exclu d’observer des évènements de fortes pluies pouvant entrainer des débordements de cours d’eau et des inondations localisées. Ainsi, il est conseillé de :
3) Recommandations pour mieux valoriser les opportunités
Au regard du caractère globalement normal de la grande saison des pluies au Sud Togo, il est recommandé aux organisations agricoles, autorités, gestionnaires des ressources en eau, Projets et ONGs d’appuyer les producteurs, y compris les femmes et les jeunes, à mieux tirer profit de la saison des pluies en :
NB : Il est recommandé aux acteurs des différents secteurs d’être attentifs aux mises à jour.